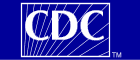 |
|
||||||||
|
|
| Home |
Volume 6 : N° 4, octobre 2009
Citation suggérée pour cet article : Fang R, Kmetic A, Millar J, Drasic L. Disparities in chronic disease among Canada's low-income populations
[Disparités dans les maladies chroniques entre les populations à faible revenu au Canada]. Prev Chronic Dis 2009;6(4).
http://www.cdc.gov/pcd/issues/2009/
oct/08_0254_fr.htm. Consulté le [date].
RÉVISION PAR LES PAIRS
Introduction
De nombreuses études ont mis en évidence des inégalités en matière de santé entre les tranches de revenu au Canada. Nous indiquons ici les variations du risque d’apparition des principales maladies chroniques entre les populations à faible revenu, par province de résidence, comme mesure de substitution de l’environnement social.
Méthodes
Nous avons utilisé les évaluations de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) de 2005 pour étudier les résidents âgés de plus de 45 ans faisant partie du quintile de revenu le plus faible au plan national. Une analyse de régression logistique multivariable a été utilisée pour examiner la relation entre la province de résidence et le risque de maladies chroniques.
Résultats
La Colombie-Britannique est la province où la population est globalement en meilleure santé, mais pas pour ses résidents à faible revenu, alors que les résidents à faible revenu du Québec sont ceux ayant le plus faible risque d’apparition des principales maladies chroniques. Les différences significatives de risque d’hypertension, de diabète et de maladies cardiaques en faveur de la Colombie-Britannique par rapport au Québec pour
la population dans son ensemble disparaissent si l’on considère uniquement le sous-ensemble de la population à faible revenu.
Conclusions
La stratégie de lutte contre la pauvreté au Québec, officialisée par une loi en 2002, a abouti à des politiques sociales et des politiques de santé qui semblent produire des résultats positifs pour les résidents à faible revenu dans la prévention des maladies chroniques. Nos conclusions démontrent que la prévalence des maladies chroniques est associée à l’investissement dans le soutien social aux populations
vulnérables.
Les déterminants socio-économiques de l’état de santé et les résultats inégaux pour la santé ont suscité un intérêt croissant au cours des dernières années de la part des chercheurs et des professionnels de la santé, ainsi que des décideurs politiques (1-6). Les inégalités en matière de santé constituent des différences injustes et évitables de l’état de santé entre les populations. Au Canada, pays doté d’un système de santé à financement public, nous constatons encore que plus les personnes se trouvent au bas de l’échelle socio-économique, plus leur espérance de vie est courte (7) et plus leur risque de souffrir de maladies chroniques est élevé (8-10).
L’état de santé est associé au comportement et aux environnements professionnels et domestiques, lesquels sont déterminés par le statut socio-économique de la personne. Par conséquent, les déterminants socio-économiques sont connus comme étant les « causes des causes » de l’état de santé (3). Les déterminants socio-économiques de l’état de santé ne sont pas simplement une mesure de la richesse, mais une synthèse de la richesse, de l’éducation, ainsi que des environnements sociaux et physiques.
L’excès de maladies chroniques dans la population à faible revenu au Canada par rapport à celle à haut revenu peut être compensé par des politiques interventionnistes. Les états de santé ont une dimension géographique importante dans les 10 provinces du Canada. En 2005, il y avait des écarts d’espérance de vie à la naissance de 3,2 ans et de 2,6 ans pour les hommes et les femmes, respectivement, entre la province ayant l’espérance de vie la plus longue, la Colombie-Britannique, et celle ayant la plus courte,Terre-Neuve et le Labrador (11). Ces différences d’espérance de vie reflètent les inégalités provinciales en matière de santé à l’échelle nationale.
Malheureusement, le Canada n’a ni système de soutien social national ni politique de santé uniforme pour corriger ces inégalités de santé entre les provinces. À la place, les 10 provinces ont 10 systèmes différents de soutien social et de santé, chacun avec des réglementations complexes. Les différences qui en résultent dans les services d’assistance sociale et de santé peuvent affecter différemment la qualité de vie et l’état de santé des résidents à faible revenu des différentes provinces.
Les inégalités de santé basées sur le statut socio-économique existent entre les tranches de revenu dans la population canadienne dans son ensemble (6-9). Cependant, on ne sait pas dans quelle mesure la santé des Canadiens à faible revenu peut être comparée entre les différentes provinces. L’objectif de cette étude était d’examiner si la province de résidence, servant de mesure d’environnement social de substitution et corrigée en fonction des covariables, est liée à la santé des Canadiens à faible revenu. Nous avons cherché à susciter des discussions sur les différences provinciales d’environnements sociaux et à fournir des données pour des approches politiques visant à réduire les inégalités de santé au Canada, qui pourraient également être étendues à d’autres pays industrialisés.
Les données utilisées dans cette étude proviennent de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (ESCC) de 2005 (12). Enquête transversale menée par Statistiques Canada, l’ESCC couvre la population de plus de 12 ans vivant en foyer privé. Les résidents des réserves autochtones, des institutions, de certaines régions éloignées et des bases militaires ne sont pas inclus. Les participants ont fourni leurs données démographiques, socio-économiques et comportementales, ainsi que des renseignements portant sur leur état de santé. Le taux de réponse à l’enquête était de 79 %, soit un échantillon de 132 947 répondants. Une description détaillée de la méthodologie utilisée dans l’ESCC est disponible (13).
Nous avons étudié les personnes de plus de 45 ans, résidant dans l’une des 10 provinces et faisant partie du quintile de revenu le plus faible au plan national. Le quintile de revenu était basé sur les ratios de distribution des revenus au plan national, par rapport aux seuils de faible revenu (14) calculés d’après le revenu du ménage, le nombre de membres de la famille et la taille de la collectivité. Les 10 provinces canadiennes étudiées étaient Terre-Neuve et le Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Québec, l’Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan, l’Alberta et la Colombie-Britannique. Quarante-cinq ans a été choisi comme âge minimum, car les maladies chroniques apparaissent généralement dans la cinquantaine. La taille de l’échantillon final était de 14 475 sujets.
Toutes les estimations de cette étude sont pondérées pour représenter la population totale dans chaque province en 2005. Pour tenir compte du modèle d’échantillonnage de l’enquête ESCC, nous avons utilisé la méthode bootstrap (15-17) afin de calculer des intervalles de confiance et des coefficients de variation, et de tester la signification statistique des différences entre les estimations; la signification statistique a été définie à P < 0,05.
Les résultats pour la santé que nous avons considérés étaient l’hypertension, le diabète, les maladies cardiaques, le cancer, les troubles de l’humeur et l’arthrite ou les rhumatismes signalés par les sujets. Des modèles d’analyse de régression logistique multivariable (18,19) ont été utilisés pour étudier le lien entre chaque résultat pour la santé et la province de résidence. Les analyses ont été corrigées en fonction de 3 facteurs démographiques (l’âge, le sexe et le statut d’immigré) et de 1 facteur socio-économique (niveau de scolarité). La méthode bootstrap a servi à tester la signification statistique des rapports de cotes et à estimer des intervalles de confiance à 95 %. Tous les facteurs comportementaux (tabagisme, consommation d’alcool, consommation de fruits et de légumes, et activité physique) ont été exclus des modèles, car s’ils agissent sur la santé, ils résultent en même temps de facteurs socio-économiques et se trouvent, par conséquent, entre les déterminants socio-économiques et les résultats pour la santé.
Si l’on envisage la population dans son ensemble, la Colombie-Britannique est la province canadienne où la population est en meilleure santé en termes de comportements et de résultats pour la santé (tableau 1). Les résidents de la Colombie-Britannique ont l’espérance de vie la plus longue, le mode de vie le plus sain (prévalence la plus élevée d’activité physique, les prévalences les plus faibles de tabagisme et d’obésité) et parmi les prévalences les plus faibles de maladies chroniques dans le pays.
Comparativement aux résidents de la Colombie-Britannique, ceux de la plupart des autres provinces sont plus susceptibles de signaler des maladies chroniques, en particulier l’hypertension, le diabète et les maladies cardiaques (tableau 2); les provinces des Prairies (Alberta, Manitoba et Saskatchewan) ne sont pas différentes pour ce qui est du diabète et des maladies cardiaques. En outre, les résidents de la Colombie-Britannique présentent une prévalence plus grande de troubles de l’humeur comparativement aux résidents du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve et du Labrador, de l’Île-du-Prince-Édouard, du Québec et de la Saskatchewan.
Si l’on envisage uniquement les populations à faible revenu, la santé des résidents de la Colombie-Britannique n’est pas meilleure que celle des autres provinces canadiennes. La Colombie-Britannique perd son avantage en matière de santé pour le diabète par rapport à toutes les autres provinces; pour l’hypertension par rapport à l’Alberta, au Manitoba, à l’Île-du-Prince-Édouard, au Québec et à la Saskatchewan; pour les maladies cardiaques par rapport à l’Ontario, à l’Île-du-Prince-Édouard et au Québec; et pour l’arthrite ou les rhumatismes par rapport à Terre-Neuve et au Labrador, au Nouveau-Brunswick, au Manitoba et à la Saskatchewan. Par rapport à la Colombie-Britannique, le Québec améliore sa position pour ce qui concerne les troubles de l’humeur et l’arthrite ou les rhumatismes, et comble son retard pour l’hypertension, le diabète et les maladies cardiaques. En fait, la santé des personnes à faible revenu dans l’ensemble des 9 provinces n’est pas tellement différente de celle de leurs homologues en Colombie-Britannique.
Dans la population à faible revenu, nous avons observé qu’aucune des autres provinces n’est significativement meilleure que le Québec pour aucune des principales affections chroniques (tableau 3). Toutes les autres provinces font nettement moins bien que le Québec pour au moins 1 maladie chronique étudiée. Par rapport au Québec, le sous-ensemble de la population à faible revenu en Colombie-Britannique a perdu son avantage en matière de santé pour l’hypertension, le diabète et les maladies cardiaques. Le Manitoba, qui fait mieux que le Québec pour le diabète et les maladies cardiaques si l’on envisage la population dans son ensemble, ne fait pas mieux si l’on considère la population à faible revenu. De même, la différence significative en faveur de la Saskatchewan par rapport au Québec pour les maladies cardiaques disparaît également dans le sous-ensemble à faible revenu.
Pour découvrir pourquoi le Québec est la province où la population à faible revenu est en meilleure santé au Canada, même si elle fait moins bien que la Colombie-Britannique pour la population dans son ensemble, nous avons étudié les facteurs sociaux et comportementaux des populations à faible revenu des deux provinces. Parmi certains facteurs sociaux et comportementaux qui contribuent au risque d’apparition de maladies chroniques, la plupart étaient nettement plus prévalents chez les résidents à faible revenu du Québec que chez ceux de la Colombie-Britannique, à l’exception de l’obésité et de la consommation régulière d’alcool, lesquels n’étaient pas significativement différents (tableau 4). La prévalence plus faible de facteurs de risques sociaux et comportementaux en Colombie-Britannique par rapport au Québec semble contredire la prévalence plus élevée des maladies chroniques considérées.
Les résultats pour la santé dépendent de la satisfaction des besoins des patients en matière de soins de santé. Nous n’avons observé aucune différence significative en pourcentage de la population dans son ensemble en matière de besoins de soins de santé insatisfaits entre le Québec (10,7 %) et la Colombie-Britannique (10,8 %) (tableau 5). Cependant, quand nous avons examiné les populations à faible revenu du Québec et de la Colombie-Britannique, nous avons observé que le pourcentage de personnes dont les besoins de soins de santé sont insatisfaits en Colombie-Britannique (15,6 %) est nettement plus élevé qu’au Québec (9,5 %). Nous avons examiné plus précisément les principaux facteurs qui distinguent les deux provinces à cet égard et nous avons observé que 31,5 % des résidents de la Colombie-Britannique, dont les besoins de soins de santé sont insatisfaits, ont signalé le coût comme étant un facteur contre seulement 6,4 % des résidents du Québec. D’autres facteurs, comme la disponibilité des soins, ne semblent pas favoriser le Québec par rapport à la Colombie-Britannique.
La capacité de payer les soins de santé des populations à faible revenu dépend dans une certaine mesure de l’assistance sociale, comme l’aide sociale. Nous avons observé que les résidents à faible revenu du Québec étaient nettement plus susceptibles d’indiquer qu’ils bénéficient d’un revenu au titre de l’aide sociale (pourcentage brut de 16,9 %) que leurs homologues de la Colombie-Britannique (pourcentage brut de 11,0 %). En corrigeant les données pour tenir compte du revenu du ménage, du nombre de membres de la famille, de la taille de la collectivité, de l’âge et du sexe, dans un modèle d’analyse de régression logistique multivariable, nous avons observé que les résidents à faible revenu du Québec sont deux fois plus susceptibles de signaler qu’ils bénéficient d’un revenu au titre de l’aide sociale que ceux de la Colombie-Britannique.
Même si la Colombie-Britannique est la province canadienne où la population est en meilleure santé dans son ensemble, ce n’est pas le cas pour sa population à faible revenu; cela l’est au Québec. Ceci est vrai bien que les profils de facteurs de risques comportementaux soient meilleurs et les niveaux de scolarité plus élevés chez les résidents de la Colombie-Britannique à faible revenu que ceux de leurs homologues du Québec. Ces résultats soulignent la possible influence des politiques sociales sur la santé.
La santé des résidents à faible revenu repose sur l’environnement politique, étiologique et socio-économique global dans lequel ils vivent. Des études menées sur les associations entre la politique, les politiques sociales et les résultats pour la santé (20,21) concluent que les politiques visant à réduire les inégalités sociales, comme celles ayant trait à l’aide sociale nationale et au marché du travail, semblent améliorer les taux de mortalité infantile et l’espérance de vie à la naissance. Les gouvernements qui conçoivent un environnement social complet, non seulement en soutenant financièrement les résidents à faible revenu, mais également en mettant en place une stratégie systématique reposant sur une parfaite compréhension de leurs besoins en matière de santé, semblent avoir une occasion unique de démontrer dans quelle mesure les inégalités de santé peuvent être corrigées.
Le Québec est l’une des deux provinces seulement ayant une stratégie complète de lutte contre la pauvreté, et c’est la seule province à avoir promulgué une loi pour combattre la pauvreté et l’exclusion sociale (loi 112). Le Collectif pour un Québec sans pauvreté (22), organisation créée en mai 2000, vise à faire progressivement du Québec, d’ici 2013, l’une des collectivités publiques industrialisées ayant les plus faibles taux de pauvreté (23). Ces actions ont contribué à l’élaboration et finalement à la promulgation de la loi 112 en décembre 2002.
Au Canada, chaque province a son propre système de soutien social et sa propre réglementation complexe qui déterminent le type d’assistance, les conditions d’octroi de celle-ci et les taux de prise en charge correspondants. Les emplois qu’occupent les personnes à faible revenu n’offrent habituellement pas de prestation de maladie ni de couverture pour les services médicaux étendus. Certaines données indiquent que la stratégie de lutte contre la pauvreté du Québec, associée à son système de soutien social unique, qui comprend un programme de soins universels pour les enfants, des déductions d’impôts et des prestations familiales pour les parents occupant des emplois à faible revenu, ainsi que des remboursements de taxe foncière pour les familles à faible revenu, est bénéfique pour cette population (24). La stratégie de lutte contre la pauvreté du Québec et son environnement social plus favorable, officialisés par une loi en 2002, peuvent expliquer les meilleurs résultats pour la santé dans la population à faible revenu du Québec par rapport à celle de la Colombie-Britannique.
L’assurance-maladie est également administrée séparément par chaque province et varie à travers le pays. De nombreux services médicaux au Canada, notamment les soins dentaires, les soins à domicile et ceux des personnes âgées, les médicaments sur ordonnance et les lunettes de vue sur ordonnance, ne sont pas considérés comme médicalement nécessaires et leurs coûts doivent être assumés partiellement ou en totalité. Au Québec, aucune prime d’assurance-maladie n’est exigée pour les enfants, alors qu’en Colombie-Britannique, les parents doivent payer des primes d’assurance-maladie pour eux-mêmes et leurs enfants. En outre, le Québec est la seule province à rembourser les nouveaux médicaments; partout ailleurs, ceux-ci doivent être réglés par le patient ou par des régimes d’assurance-médicaments privés dont ne disposent habituellement pas les personnes à faible revenu. Le Québec a également davantage de ressources de soins de santé. À titre d’exemple, en 2006, le nombre de médecins spécialistes était de 106 pour 100 000 habitants au Québec contre 90 pour 100 000 habitants en Colombie-Britannique (25).
Notre étude a certaines limites. Certains groupes vulnérables, comme les populations autochtones vivant dans des réserves et les personnes sans domicile fixe, n’ont pas été pris en compte dans l’échantillon utilisé pour l’enquête. Les enquêtes de population basées sur la mémoire des répondants peuvent surestimer ou sous-estimer des diagnostics. Enfin, la petite taille de l’échantillon du groupe de population cible limite la puissance statistique permettant de tester des différences entre les provinces.
Le statut des populations à faible revenu en regard des maladies chroniques varie considérablement entre les provinces canadiennes en raison des différences de comportement, de politique sociale et peut-être d’environnement social. L’adoption de la bonne stratégie de lutte contre la pauvreté au plan national pourrait corriger les effets de la pauvreté sur la santé. La réduction des inégalités en matière de santé grâce à une politique interventionniste efficace dans chaque province canadienne pourrait également diminuer les coûts des maladies chroniques pour le système de santé. Les conclusions de cette étude indiquent une possible voie qui va du renforcement des politiques sociales à l’amélioration des résultats pour la santé pour les populations vulnérables.
Nous remercions Mlle Darlene McCauley pour l’aide administrative apportée.
Auteur correspondant : Raymond Fang, docteur en médecine, Services de santé provinciaux de Colombie-Britannique, 700-1380 Burrard St, Vancouver, BC V6Z 2H3, Canada. Téléphone : 604-875-7355. Courriel : rfang@phsa.ca.
Affiliations d’auteur : Andrew Kmetic, John Millar, Lydia Drasic, Services de santé provinciaux de Colombie-Britannique, Vancouver, Colombie-Britannique, Canada.
|
|
|
|
|
|
The findings and conclusions in this report are those of the authors and do not necessarily represent the official position of the Centers for Disease Control and Prevention.
Privacy Policy | Accessibility This page last reviewed October 25, 2011
|
|